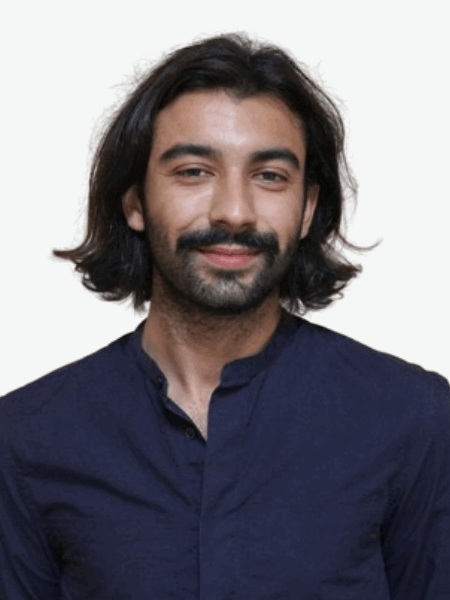Parmi les vêtements et autres produits en coton qui constituent notre garde-robe, on estime qu’un sur cinq sont entachés de travail forcé de certaines minorités. 160 millions d’enfants, soit un enfant sur dix dans le monde est astreint au travail, un nombre qui a augmenté ces dernières années notamment dans les chaînes d’approvisionnement des produits agricoles et miniers où ils recueillent entre autres le cacao, la vanille et le cuivre.
En effet, la mondialisation (délocalisations et sous-traitances), a engendré des vides juridiques en matière de respect des droits humains dans les chaînes d’approvisionnement. Ces disparités entre normes nationales ont permis à certaines entreprises, en délocalisant leur production vers des territoires moins régulés, de bénéficier d’avantages compétitifs au détriment des conditions de travail et du respect de l’environnement.
Néanmoins, l’année 2024 marque un tournant en matière de respect des droits humains et des normes environnementales par les entreprises. Les derniers textes de l’Union Européenne : la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) applicable au 1ᵉʳ janvier 2024 (avec la double matérialité financière et d’impacts) et la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) dont l’adoption finale est attendue courant 2024 (et leur extraterritorialité) consacrent sous la forme d’obligations contraignantes le respect des droits humains et de l’environnement par les entreprises. Après la France, l’Allemagne et la Norvège, l’UE consacre 25 ans de (r)évolution silencieuse du droit.
La prise de conscience fut déterminante à Davos en 1999, lorsque Kofi Annan a appelé les entreprises à “donner une face humaine au marché”, les invitant à adhérer au Pacte Mondial de l’ONU en s’engageant à intégrer et à promouvoir 10 principes clés relatifs aux droits humains, aux normes de travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption.
L’architecte du Pacte Mondial, le Professeur de Harvard John Ruggie, développa par les Principes Directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (PDNU, 2011) un texte clé de “droit souple” ayant permis de clarifier les obligations et responsabilités respectives des États et des entreprises en matière de droits humains et de définir la mise en œuvre concrète du respect des droits humains par les entreprises de tous secteurs, tailles et pays.
L’intégration du “droit souple” sur l’ensemble de la chaîne de valeur des entreprises a été initialement révolutionnaire, remettant en question des aspects essentiels du droit des affaires. Au fil des contrats et des codes de conduite, il s’est “endurci”, devenant un élément central de la gestion des activités, voire un fondement de certaines décisions judiciaires et arbitrales. Cette responsabilité incombant aux entreprises de respecter les droits humains a donc d’abord été marquée par l’intégration d’un droit souple qui résultait de règles de droit international public normalement réservées aux États, une première (r)évolution.
Une grande partie des produits mis sur le marché par les entreprises étant fabriqués dans des pays plus laxistes en matière de droits humains, il convenait, et c’est aussi une (r)évolution du droit, d’imposer ce droit souple dans toute la chaine d’approvisionnement (contrats d’achat). Ainsi, une extension “extraterritoriale” de ce droit s’est imposée, rendant les entreprises responsables des violations de droits humains causées en dehors de leur territoire d’implantation.
La responsabilité civile est aussi (r)évolutionnée. Une responsabilité transnationale s’est imposée sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, levant le voile de la personnalité juridique qui permettait jusqu’alors de se distancer juridiquement du risque humain ou environnemental.
En pratique, cette (r)évolution s’est manifestée par l’exigence nouvelle d’une “licence sociale et environnementale d’opérer” (LSEO) venue s’ajouter à la “licence légale ou administrative” délivrée par les États. Si cette dernière est clairement définie par les textes, la LSEO n’a pas de définition précise, varie d’un projet à l’autre et oblige les entreprises à une vigilance/des diligences particulières et permanentes.
La prise de conscience de la nécessité d’un meilleur équilibre entre la “face financière” et une “face humaine” du marché s’est ainsi progressivement imposée. La société civile y a d’ailleurs largement contribué. Mais, d’une part, la multiplication de violations par certaines entreprises peu scrupuleuses, leur médiatisation (sanctions de réputation) et judiciarisation croissante par des tribunaux audacieux, et, d’autre part, le souhait d’entreprises vertueuses d’assurer être toutes sur un même “pied d’égalité” et éviter une fragmentation du droit qui leur est applicable, a souligné les limites du “droit souple” non contraignant.
L’architecture novatrice des normes européennes répond à ce besoin d’effectivité. Suivant les initiatives législatives nationales française, norvégienne et allemande, l’Union européenne a pris le relais pour harmoniser le droit applicable en matière de droits humains et principes ESG dans le cadre des objectifs du Pacte Vert. C’est à cette fin (rendre l’Europe climatiquement neutre en 2050) que s’inscrivent les directives sur le reporting extra financier (en vigueur depuis le 1ᵉʳ janvier 2024) et sur la diligence raisonnable en matière de respect des droits humains et de l’environnement (approbation finale attendue courant 2024). Ces Directives qui atteignent toutes les chaines de valeur et qui sont aussi applicables à certaines sociétés non-européennes consacrent largement en “droit dur” cette (r)évolution du droit décrite ci-avant.
La mise en œuvre de ce nouveau droit fait l’objet de nombreux textes d’application et la (r)évolution du droit se poursuivra via son hybridité : entre droit, management, comptabilité et nouvelles technologies (blockchain et IA).
Stéphane Brabant, Avocat à la Cour, Senior-Partner chez Trinity International AARPI. Claire Bright, Professeure Associée et Directrice du Centre Entreprises, droits humains et environnement à l’Université Nova de Lisbonne. Luca Tenreira, Doctorant en Droit à l’Institut Universitaire Européen.